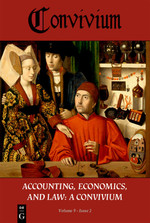Responsabilité sociale des entreprises | Page 33
actualités internationales Gouvernance Normes d'encadrement normes de droit Nouvelles diverses Responsabilité sociale des entreprises
Loi PACTE et droit des sociétés
Ivan Tchotourian 20 septembre 2019 Ivan Tchotourian
Le quotidien Les Échos fait paraître un bel article portant sur la loi PACTE dans se version droit des sociétés intitulé : « Loi Pacte : les différences entre intérêt social, raison d’être et société à mission » (19 septembre 2019).
Résumé :
La loi Pacte entend repenser la place des entreprises dans la société. Cela passe par trois mesures « d’ouverture » : l’intérêt social élargi, la possibilité de doter la société d’une raison d’être ou de lui donner une mission. Découvrez les différences entre ces trois notions.
À la prochaine…
actualités internationales Gouvernance normes de droit Nouvelles diverses Responsabilité sociale des entreprises
Une « raison d’être » pour les entreprises publiques
Ivan Tchotourian 13 septembre 2019 Ivan Tchotourian
Bonjour à toutes et à tous, article de Les Échos.fr qui vous intéressera : « Le Maire pousse les entreprises publiques à se doter d’une « raison d’être » » (Les Échos.fr, 13 septembre 2019).
Extrait :
Les entreprises dont l’Etat est actionnaire vont devoir se trouver une raison d’être. Il ne s’agit pas d’une raison d’exister à proprement parler mais plus prosaïquement de définir un objet social. Le Code civil et le Code de commerce ont en effet été changés par la loi Pacte, promulguée au printemps dernier, afin de permettre aux entreprises qui le veulent de définir quelle est leur responsabilité dans la société, au-delà de la recherche de bénéfices.
C’est Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, qui l’a annoncé jeudi à Bercy. « Je demande à Martin Vial [le directeur de l’Agence des participations de l’Etat, NDLR] que toutes les entreprises dont l’Etat est actionnaire se dotent d’une raison d’être en 2020 », a-t-il déclaré. L’APE gère aujourd’hui les participations de l’Etat dans 88 entreprises. Bruno Le Maire souhaite aussi que « la Banque publique d’investissement (BPI) entame la même démarche en 2020 auprès des entreprises dans lesquelles elle investit », ce qui concerne environ 90 entreprises.
À la prochaine…
actualités internationales Gouvernance Normes d'encadrement Responsabilité sociale des entreprises
Ownership (Lost) and Corporate Control: An Enterprise Entity Perspective
Ivan Tchotourian 12 septembre 2019 Ivan Tchotourian
Merci à Yuri Biondi de publier des textes toujours aussi intéressant ! Je vous invite à lire son dernier article : « Ownership (Lost) and Corporate Control: An Enterprise Entity Perspective » (Accounting, Economics, and Law: A Convivium, 2019)
Résumé :
In recent decades, advocates of the shareholder value perspective regarding corporations have depicted the shareholding investor as the owner of the corporation and the entrepreneur proprietor of corporate activity. Political discourse and regulatory frameworks keep imagining that one single subject or legal person holds the whole bundle of rights and responsibilities related to corporate investment, management and control. This subject would be the shareholding investor (acting as the owner of the corporation), while the bundle would be embodied in the one kind of security issued by the corporation, that is, the share.
As a matter of fact, corporate practice shows fundamental disconnection between equity investment, enterprise management and corporate control. Over time, three main legal-economic innovations have featured this disconnection: (i) the very introduction of the corporate legal form; (ii) the working of corporate groups and financial intermediaries; and (iii) the overwhelming web of contractual arrangements and financial derivatives which characterise business affairs of listed companies and equity markets nowadays.
In this context, this article argues that an ownership view of corporate activity misleads understanding and undermines efforts to enforce corporate sustainability, responsibility and accountability. Ownership and market are insufficient to assure this enforcement, while ownership sovereignty is irremediably lost. Insisting on such misunderstanding would result in facilitating if not favouring structuring opportunities to circumvent control and responsibility, including through regulatory avoidance.
Instead, an enterprise entity view may comprehend the corporate activity (of which the corporation is one possible legal form, often embedded in a more complex legal structure involving an enterprise group) as an organisation and an institution which responds to and must submit to a variety of inside and outside checks and balances, with a view to assuring its consistent and continued role in business and society. From this systemic perspective, consolidated accounting and disclosure may represent a fundamental element of the institutional system of protection. In particular, a comprehensive accounting system – based upon economic substance (rather than legal form) – may make enterprise groups accountable for their ongoing activities to stakeholders (including shareholders), human community and nature.
À la prochaine…
actualités canadiennes Gouvernance normes de droit Nouvelles diverses Publications publications de l'équipe Responsabilité sociale des entreprises
Nouveau billet sur Contact : la fonderie Horne en question
Ivan Tchotourian 1 septembre 2019 Ivan Tchotourian
Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier mon dernier billet de Contact intitulé : « Fonderie Horne et arsenic : une insoutenable légèreté » (partie 1 et partie 2). J’y aborde la question de la RSE.
Extrait :
L’actualité en matière de responsabilité sociale (RSE) vient de s’enrichir d’une nouvelle diffusée récemment par Radio-Canada : le niveau de pollution par contaminants d’une entreprise de Rouyn-Noranda et toléré par le ministre de l’Environnement. « Québec permet à la Fonderie Horne d’émettre 67 fois plus d’arsenic dans l’air que la norme provinciale » (Radio-Canada, 13 mai 2019), voilà une information qui n’est passée inaperçue ! Amené à me prononcer dans le cadre de l’émission de télévision RDI Économie animée par M. Gérald Fillion (ici), je partage avec vous quelques réflexions sur cette actualité (en plus de faire le point avec du recul), réflexions qui sont celles d’un professeur de droit travaillant dans le domaine de la RSE… et, surtout, celle d’un citoyen et d’un père qui se veut critique sur une situation qui lui apparaît insoutenable.
Plusieurs solutions sont envisageables pour répondre au niveau de pollution occasionné par les activités de la fonderie Horne. Le coût social de la pollution (qui, à terme, va reposer sur la province et ses contribuables) et les inquiétudes multiples de la situation appellent une réponse et un signal fort envoyé à la communauté et aux entreprises. J’ai entendu que fermer l’usine serait une option. Elle ne me semble pas crédible. Elle vient opposer frontalement la logique environnementale à la logique économique, alors qu’il convient de les faire travailler ensemble. La fermeture aurait des conséquences dévastatrices sur le plan économique, il ne faut pas s’en cacher. De même, des mesures punitives ne me semblent guère crédibles, le ministère étant le principal responsable du niveau de pollution atteint (et non l’entreprise qui ne fait qu’utiliser une tolérance – en étant d’ailleurs en-dessous du seuil maximum –). Comme évoqué par certains dans les journaux, la mise en place d’une zone tampon serait une avenue (et le respect de mesures sanitaires de base), même si cette option est contraignante pour les citoyens concernés, demeure à court terme et ne règle pas le problème de fond : le niveau de rejet des contaminants dans l’air. Aussi, il apparaît impératif de rehausser la norme demandée à l’entrepise Horne, tout en mettant en place des incitatifs pour la soutenir dans la recherche d’une solution environnementale.
Ne pas oublier la responsabilité de l’État
Que penser d’un éventuel recours judiciaire exercé non contre l’entreprise (qui reste dans la tolérance octroyée et ne franchit pas la ligne de l’illégalité) mais contre l’État ? Si la fonderie Horne suit bien le protocole (qui serait même en avance sur l’échéancier fixé avec le ministère de l’Environnement) suivant ce qu’avance le ministre Benoît Charette, la question est entière de savoir si les chiffres négociées et visés dans le protocle étaient adéquats. Que penser de la décision prise en 2011 par le ministère de l’Environnement ? Ne caractérise-t-elle pas une faute, une irrationnalité, une déraisonnabilité ou une insouciance grave commise par l’État ? Ces mots ne sont pas pris au hasard, ils ont des conséquences juridiques.
Contrairement à une croyance répandue, l’État québécois ne bénéficie pas d’une irresponsabilité. La maxime « the King can do no wrong » a vécu. La Cour suprême a clairement rappelé cette idée en 2011 : « Il importe que les organismes publics soient responsables en général de leur négligence compte tenu du grand rôle qu’ils jouent dans tous les aspects de la vie en société. Soustraire les gouvernements à toute responsabilité pour leurs actes entraînerait des conséquences inacceptables ». L’État québécois a tout d’abord une responsabilité extracontractuelle directe. Avec l’adoption en 1994 du Code civil du Québec (et l’article 1376), a été ajouté une nouvelle dimension à l’assujettissement de l’État au droit commun de la responsabilité civile. Le droit québécois assimile purement et simplement le gouvernement à une personne physique majeure et capable pour tout recours dirigé contre lui. Mais, l’État québécois peut également répondre de la faute de son préposé en vertu des articles 1463 et s. du Code civil du Québec. Avec cet article, le législateur cherche à écarter la possibilité pour l’État de se défendre en arguant que son préposé aurait agi en dehors de l’exercice de ses fonctions et que, pour ce motif, l’État n’aurait pas à répondre de sa faute.
Toutefois, la chose est subtile. En effet, le niveau de responsabilité de l’État québécois dépend de la nature de la décision prise. Il convient de distinguer entre les décisions relevant du « politique » et celles relevant de « l’opérationnel ». La nature de la faute exigée de l’État change. Si l’acte politique échappe la plupart du temps à la sanction des tribunaux et conduit à une immunité (sauf mauvaise foi, irrationalité ou insouciance grave), l’acte de gestion peut donner lieu à une action en responsabilité si l’acte en question a été accompli fautivement (une faute simple) et que cette faute a causé un dommage. Pour savoir à quelle catégorie appartient l’acte, il est « (…) illusoire de vouloir établir un critère absolu qui donnerait rapidement et infailliblement une réponse à l’égard de toute décision parmi la gamme infinie de celles que peuvent prendre les acteurs gouvernementaux ». L’appréciation se fait de manière contextuelle en tenant compte des caractéristiques des pouvoirs que la loi confère, ainsi que des devoirs qu’elle impose à l’officier public chargé de l’appliquer.
Quelle que soit la nature de l’acte en cause (qui m’apparaît toutefois relever davantage de l’opérationnel quoique…), on constate que l’on est proche d’une mise en cause possible de la responsabilité de l’État québécois dans ce dossier. Au regard des conséquences graves de l’arsenic sur la santé et du niveau de contaminants admis (et aussi de la légèreté à aborder ce problème de pollution), même les hypothèses exceptionnelles de faute mettant au rancart l’immunité – dans le cas des décisions politiques – semblent vérifiées. Que l’État se méfie, l’actualité démontre que la société civile dans toute sa diversité de courants, d’organisations et de mouvement d’opinion n’hésite plus à mettre les États et les villes devant les tribunaux en matière de changement climatique. La justice climatique prend corps !
La Loi sur la qualité de l’environnement et son chapitre III sur le droit à la qualité de l’environnement et à la sauvegarde des espèces vivantes méritent également d’être évoqués. Les mots utilisés dans la loi sont forts de sens : « Toute personne a droit à la qualité de l’environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent ». Les articles 19.1 et s. permettent l’exercice d’un recours en injonction devant la Cour supérieur pour empêcher l’acte. Cependant, il a été observé que ces articles sont difficiles à invoquer en pratique. De plus, le ministère de l’Environnement a autorisé la fonderie Horne à déroger à la loi.
À la prochaine…
actualités canadiennes Gouvernance Nouvelles diverses Responsabilité sociale des entreprises Valeur actionnariale vs. sociétale
Opioïdes : quelle RSE pour les pharmaceutiques ?
Ivan Tchotourian 30 août 2019 Ivan Tchotourian
M. Gérard Fillion livre une belle réflexion sur l’irresponsabilité des grandes entreprises pharmaceutiques dans un article paru hier : « Opioïdes : l’avidité des pharmaceutiques » (Radio-Canada, 29 août 2019).
Extrait :
(…) Nous savons aujourd’hui que plusieurs pharmaceutiques ont fait croire à des milliers de médecins que les bénéfices des opioïdes étaient supérieurs à leurs effets néfastes. Elles ont sous-estimé les risques, notamment ceux associés à une dépendance marquée à ces médicaments. Des documents déposés en cour aux États-Unis montrent clairement que des entreprises savaient qu’il y avait des risques majeurs de dépendance.
Non seulement elles connaissaient les risques, mais elles ont fait fi des dangers pour encourager les médecins à prescrire toujours plus d’opioïdes. Le jugement rendu en Oklahoma en début de semaine est troublant.
(…) Au nom du profit, une crise épouvantable a été créée. C’est certainement la part la plus sombre de notre système économique.
À la prochaine…
Gouvernance Nouvelles diverses Responsabilité sociale des entreprises Valeur actionnariale vs. sociétale
Milton Friedman is right, profit is a company’s only purpose
Ivan Tchotourian 29 avril 2019 Ivan Tchotourian
Dans un article du Financial Post de janvier 2019, Terence Corcoran revient sur les thèses de Milton Friedman pour les appuyer au travers d’arguments intéressants. Je vous invite à lire son analyse dans l’article suivant : « Milton Friedman is right, profit is a company’s only purpose » (Financial Post, 19 janvier 2019)
Petit extrait :
There is nothing in the redefine-capitalism movement that was not identified almost 50 years ago by Friedman as a danger to markets and economic freedom. The concepts and principles reviewed in his 1970 essay, ignored by Mayer and all the reformers, are as relevant today as they were then.
Generally, Friedman would have no problem with corporations that engage in virtue signalling. For example, Gillette’s “toxic masculinity” ad is an obvious attempt to sell products by piggybacking on a controversial social issue. Gillette is acting out of self-interest.
Friedman declined to denounce such corporate attempts to “generate goodwill” and draw attention to their products, although he warned that the strategic pursuit of social approval and conflict amounted to “hypocritical window-dressing.”
It is utterly false to portray corporations as manufacturers of profits at the expense of society. Today’s corporations, from Microsoft Corp. to GM to Amazon.com Inc., survive by producing goods and services that feed, clothe, transport, entertain and otherwise provide benefits to billions of people.
The corporate adoption of social purposes would take focus away from these core business purposes. Worse, expanding the number of corporate purposes places an undesirable undemocratic framework on corporate executives. As Friedman saw it in 1970, giving social and political responsibilities to business leaders installs unelected corporate managers in positions of unelected power
À la prochaine…
Gouvernance Nouvelles diverses rémunération Responsabilité sociale des entreprises
Des primes vraiment méritées pour les dirigeants ?
Ivan Tchotourian 17 avril 2019 Ivan Tchotourian
Bonjour à toutes et à tous, TVA nouvelles a relayé il y a peu un article du Journal de Montréal de Philippe Orfali sur les primes juteuses pour «fidéliser» les fondateurs et la haute direction des sociétés québécoises cotées en bourse. Les sociétés continuent d’offrir à leurs dirigeants de généreuses primes visant à les « fidéliser » ou à les retenir, et ce, même s’il s’agit d’entreprises auxquelles ils sont très attachés, en raison de liens familiaux.
Or, comme le souligne le porte-parole du MÉDAC (Willie Gagnon) «On comprend que lorsque vient le temps d’attirer de nouveaux membres de la direction, il faille offrir des incitatifs. Mais quand on vient de la famille qui contrôle, on a déjà un intérêt à long terme dans la société par la participation massive au capital et au contrôle de l’entreprise».
«Il n’y a pas lieu d’avoir d’incitatif à long terme versé! L’incitatif ici, c’est le contrôle et la performance de la société», ajoute-t-il.
La notion de rémunération concurrentielle ne devrait pas s’appliquer quand on détient des centaines de millions ou des milliards dans cette même entreprise, selon lui.
À réfléchir !
À la prochaine…