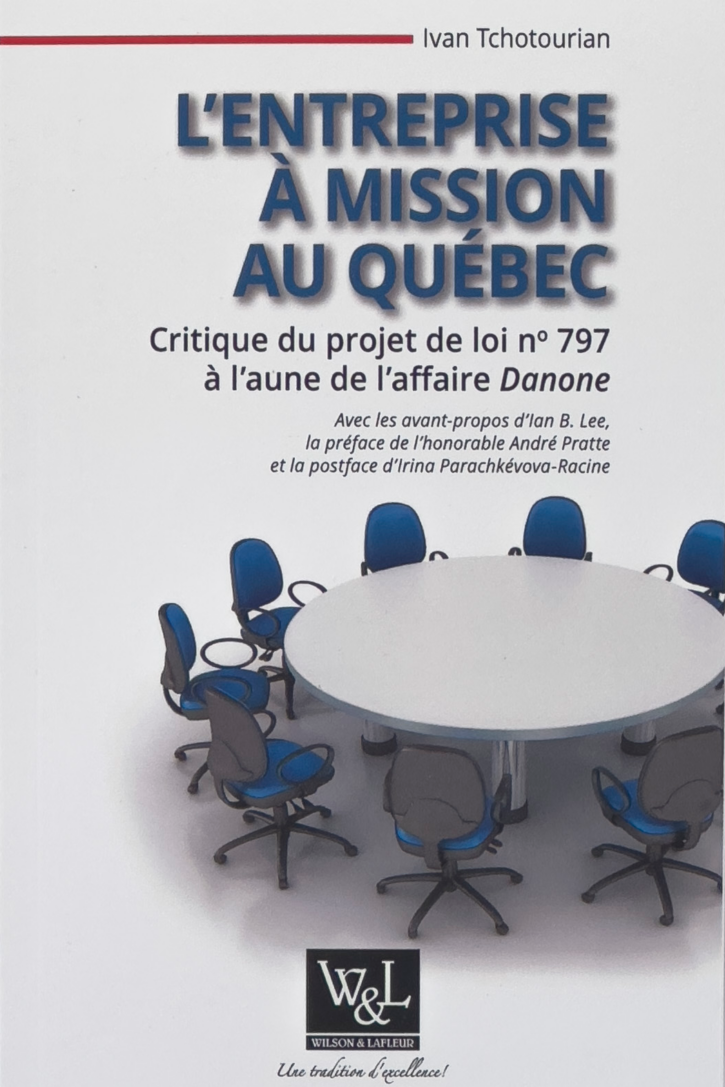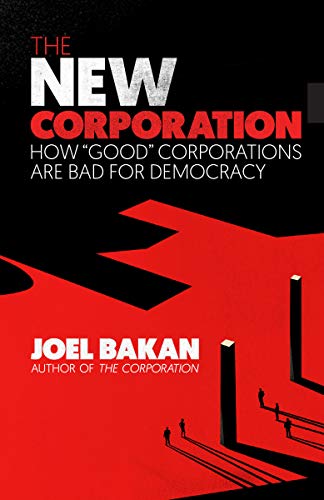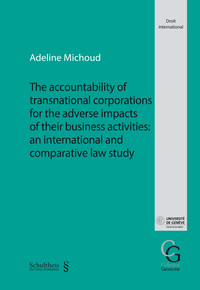devoir de vigilance Divulgation divulgation extra-financière opinions Publications Responsabilité sociale des entreprises
OPINION : Directive sur la vigilance des entreprises, une durabilité à petits pas
Ivan Tchotourian 15 avril 2024
Après de nombreux mois de négociations et une volte-face de dernière minute, la directive européenne sur le devoir de vigilance devrait être adoptée sous peu. Les États membres du Conseil européen ont en effet trouvé un accord le 15 mars 2024. Quelques jours plus tard, c’est la Commission des affaires juridiques du Parlement européen qui a approuvé l’accord sur le projet. Si la version préliminaire de la directive affichait de fortes ambitions, le texte témoigne de reculs, fruits de concessions. Néanmoins, cette directive demeure un texte historique qui détaille les obligations de vigilance des entreprises au regard des droits humains, de l’environnement et du climat et qui met en place des mécanismes de contrôles et d’accès à la justice, le tout à l’échelle européenne (!).
Le projet de directive a vu son champ d’application se réduire. En effet, elle ne concerne désormais que les entreprises de plus de 1 000 salariés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 450 millions €. Les entités hors UE, dont les entreprises canadiennes, devront réaliser un chiffre d’affaires de plus de 450 millions € en Europe pour être concernées. Au départ, le texte s’appliquait aux entreprises rassemblant plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires mondial supérieur ou égal à 150 millions € (ou, pour les entreprises non européennes de 300 millions € générés dans l’UE). Bien que les seuils ont donc été revus à la hausse, ils sont en réalité évolutifs, ces chiffres passant de 4 000 salariés et 900 millions € de chiffre d’affaires dans quatre ans, les autres entreprises étant visées dans cinq ans. Mais, l’application de la directive aux entreprises de certains secteurs considérés comme « à risque » (textile, agriculture, industrie minière…) a été malheureusement abandonnée. En bout de ligne, seulement 0,05 % des entreprises européennes (5 000 entreprises) vont être concernées par la directive, soit une diminution de 70 % des entreprises visées par rapport au texte validé en décembre 2023, du moins sur les trois premières années.
Les entreprises vont être tenues d’identifier, de prévenir et de supprimer les atteintes aux droits humains et à l’environnement issues de leur activité et de celle de leurs partenaires directs au sein de leur chaîne d’approvisionnement. Dans les grandes lignes, les entreprises vont ainsi devoir :
- Identifier, évaluer et hiérarchiser les risques en matière de droits humains, de droits des travailleurs, et de l’environnement liés à leurs activités et à leurs partenaires directs;
- Mettre en place des mesures préventives pour prévenir les violations des droits humains et des droits environnementaux;
- Instaurer des mécanismes de suivi et d’évaluation pour vérifier l’efficacité de leurs mesures préventives et pour identifier les éventuels impacts négatifs sur les droits humains et l’environnement;
- Inclure dans leur rapport annuel des informations détaillées sur les mesures prises pour identifier, prévenir et atténuer les risques identifiés, issues de leur activité et de celle de leurs partenaires directs ainsi que leur résultat.
Point intéressant, les entreprises devront intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques et systèmes de gestion des risques, ainsi qu’adopter et mettre en œuvre un plan de transition rendant leur modèle d’entreprise compatible avec l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C prévu par l’Accord de Paris. En dépit de ces avancées, il faut tout de même regretter que des pans entiers des opérations en aval de la chaîne de valeur de l’obligation de vigilance, telles que les opérations de démantèlement et recyclage, de même que l’abandon des incitants aux plans de transition climatique ont été exclus. Dans le même sens, le lien entre plan de transition climatique et rémunération variable des dirigeants a été supprimé.
La directive n’a pas abandonné les sanctions puisqu’en cas de non-respect des obligations de diligence nécessaires, des amendes sont prévues qui ne peuvent pas dépasser 5 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise. Attention toutefois, l’engagement de la responsabilité des entreprises et ses modalités seront décidés par les États lors de leur transposition.
Quand on compare le projet et le résultat, l’Union européenne démontre que les États résistent parfois et que les entreprises n’accueillent pas facilement ce genre d’initiatives, malgré leurs volontés affichées. Bien que le Canada a été critiqué au moment de l’adoption de sa Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement, on se rend compte qu’elle le mérite d’exister. Avec la directive européenne, il n’en demeure pas moins que les droits humains et les enjeux sociétaux et climatiques s’intègrent dans la gouvernance des entreprises européennes… un message que le gouvernement du Canada devrait entendre pour travailler à un renforcement de la loi adoptée en 2023 (adoption d’un plan, ouverture au climat…) et que les entreprises devraient recevoir pour améliorer leurs pratiques et soutenir les initiatives législatives. C’est à ce prix que le Canada demeurera compétitif par rapport à ses concurrentes outre-Atlantique.
Base documentaire Gouvernance loi et réglementation normes de droit Publications publications de l'équipe Responsabilité sociale des entreprises Structures juridiques
Entreprise à mission : Danone et le projet de loi québécois 797
Ivan Tchotourian 31 octobre 2023 Ivan Tchotourian
Nouvelle publication sous ma plume portant sur l’entreprise à mission : « L’entreprise à mission au Québec : Critique du projet de loi no 797 à l’aune de l’affaire Danone » (Wilson & Lafleur, juin 2023). Cet ouvrage est l’occasion de revenir sur l’entreprise à mission, le projet de loi québécois et de mener une étude de terrain autour du cas Danone.
Merci à Irina Parachkévova-Racine, à André Pratte et à Ian B. Lee d’avoir contribué à cet ouvrage par les avant-propos, préface et postface.
- Pour accéder à la table des matière de cet ouvrage : cliquez ici
Résumé :
En 2021, le Québec a fait entrer l’entreprise à mission sur la scène juridique provinciale. Il rejoint ainsi la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse, et d’autres États tels que les États-Unis, la France, l’Angleterre… Avec le projet de loi no 797, Loi modifiant la Loi sur les sociétés par actions afin d’y intégrer l’entreprise à mission, le droit des sociétés par actions fait place à une entreprise lucrative qui allie rendement financier et mission sociale, inspirée de la Benefit Corporation étatsunienne. Dans ce projet, le choix est fait de consacrer une structure spécifique dotée de la personnalité morale. La finalité de l’entreprise, sa gouvernance et sa transparence sont repensées.
Ce projet de loi est innovant, car source d’une salutaire rupture. Au regard des lois adoptées ailleurs, il manque toutefois d’ambition et son contenu doit être bonifié. En outre, la récente polémique autour du groupe Danone illustre les limites de l’entreprise à mission, cette dernière n’étant pas exempte des menaces liées aux logiques de marché. Conseil d’administration et actionnaires sont la pierre angulaire du succès de ce type d’entreprise. Cet ouvrage propose donc plusieurs pistes destinées à améliorer ce projet de loi.
À la prochaine…
actualités canadiennes Gouvernance opinions Publications rémunération Responsabilité sociale des entreprises
OPINION : Les boni de la discorde
Ivan Tchotourian 10 mai 2022 Ivan Tchotourian
Le
sujet de la rémunération de la haute direction ne cesse d’animer la gouvernance
d’entreprise, encore plus lorsque vient le temps des assemblées annuelles.
Cette fois, ce sont les boni (ou primes de rendement) versés aux hauts dirigeants
de plusieurs sociétés d’État qui sont pointés du doigt et dénoncés dans la
presse[1]. Le sujet a même rebondi à
l’Assemblée nationale. Le premier Ministre a pris l’engagement d’y mettre fin,
du moins éventuellement[2]. La réaction de la classe
politique québécoise illustre le profond malaise existant entre rémunération de
la direction et fonds publics.
Raison
d’être et objectifs
Les régimes de rémunération sont
conçus pour répondre à trois objectifs : attirer le meilleur dirigeant, le
fidéliser et l’inciter à avoir le meilleur rendement possible[3]. La rémunération
constitue un moyen pour une entreprise de trouver et de conserver l’élément le
plus adéquat pour satisfaire ses besoins en compétence. En effet, dans les
organisations à vocation commerciale, les motivations intrinsèques occupent une
place moindre. La « bonne rémunération » est d’autant plus importante
que les hauts dirigeants sont sur un marché des dirigeants et ne sont pas à
l’abri d’être courtisés par des sociétés concurrentes. Ce risque permanent
conduit les entreprises à devoir toujours réajuster les conditions salariales.
Or, comme tout marché, dès lors que la qualité d’un bon dirigeant est perçue
comme un avantage concurrentiel, il devient inévitable que les sociétés sont
tentées de fixer des barrières aussi élevées que possible à l’entrée du marché
des dirigeants pour restreindre autant que possible la capacité de séduction de
la concurrence. À cela, s’ajoute une concurrence accrue entre les grandes
entreprises du fait de l’internationalisation des marchés. De plus, la
rémunération est certes un moyen de récompenser les efforts accomplis, mais
elle est aussi un encouragement à travailler toujours plus et mieux. Il ne
s’agit pas de demander aux hauts dirigeants de rester dans leur zone de confort
en fournissant le minimum, mais bien d’aller chercher au-delà pour faire
croitre la prospérité et la productivité de l’entreprise. L’atteinte de paliers
ou de seuils corrélée à des objectifs le plus souvent économiques (part de
marché, valorisation boursière, chiffre d’affaire, bénéfice) contribue
directement à aligner l’arbitrage du dirigeant sur la politique à adopter pour
la société sur son augmentation de rémunération. C’est alors le talent de
gestionnaires qui est récompensé. Tout cet argumentaire a du sens et a
d’ailleurs était récemment utilisé par le P.D.-G. d’Investissement Québec (IQ)[4], mais…
Des dérives
Le niveau de la rémunération
des hauts dirigeants agace et crée des crispations dans la société québécoise[5]. Les
entreprises ne peuvent s’en prendre qu’à elles-mêmes : depuis plus d’une
quinzaine d’année, force est de constater que le niveau et la composition de la
rémunération interrogent. Complexité, tendance haussière, stratégie de
légitimation ressemblant à du lavage… sont autant de maux. Au fil du temps, le sacrosaint
lien entre rémunération et performance a même été remis en question; les
travaux démontrant son incertitude. Les hauts dirigeants sont souvent récompensés lorsque le cours de l’action d’une
entreprise grimpe, tandis qu’ils ne sont que rarement sanctionnés lorsque
l’action baisse. La multiplication accrue des régimes incitatifs basés sur
des mesures particulières de performance et des référentiels assure d’ailleurs aux
P.-D.G. des montants supplémentaires dans à peu près toutes les circonstances[6]. Les réalités économiques des entreprises ne sont que
trop rarement prises en considération (salaire moyen, bénéfices…) pour fixer la
rémunération. Pour les primes au rendement dans les sociétés d’État à visée
lucrative, la Vérificatrice générale du Québec avait constaté en 2019 que la
rémunération incitative faisait partie intégrante de la rémunération attendue
des hauts dirigeants, faisant peu de place à l’évaluation de la performance
notamment individuelle[7].
La chance s’avère finalement être le facteur explicatif principal du niveau de
rémunération des hauts dirigeants. Les crises économico-financière et
la pandémie ont confirmé que les rémunérations échappaient à toute règle
logique économique : certaines (rares) ayant disparu, d’autres étant maintenues,
d’autres encore étant diminuées ou augmentées. Les rémunérations influencent
même certaines stratégies financières (rachat d’actions…), critiquées à juste
titre dans la presse spécialisées, qui n’ont pas d’autres justifications que de
maintenir un haut niveau de rémunération des dirigeants. Le fameux « pile,
je gagne ; face, tu perds » cher à Joseph
Stiglits s’applique particulièrement bien à la rémunération des hauts
dirigeants. L’application de critères ESG (environnement, social et
gouvernance) ou de la responsabilité sociale à la rémunération progresse, mais se
fait encore trop attendre en ce domaine, malgré les préconisations de certaines
autorités boursières (comme l’AMF France). Les réformes adoptées dans certains
pays (tel le vote des actionnaires) ne changent rien à ce phénomène. Alors,
pourquoi ce sujet continue-t-il d’irriter autant le Québec ? Pour une raison
simple : la rémunération des hauts dirigeants vient ébranler le pacte
social. Les différences salariales trop importantes incommodent une partie des Québécois.
Comment justifier raisonnablement que certains gagnent en quelques heures ce
que d’autres mettent une année à gagner ? L’influence de la pratique des
entreprises privées sur celle des entreprises publiques et des organisations
proches de l’État se fait de plus en plus ressentir. Or, elle demeure critiquée
quand la rémunération des dirigeants est en jeu. D’un enjeu propre à
l’entreprise, la rémunération devient un enjeu de société. Équité et justice
sociale sont balayées.
Sociétés d’État, CDPQ…
Le sujet de la rémunération
est encore plus sensible lorsque ce sont les hauts dirigeants de sociétés
d’État (SAQ et Loto-Québec), de la Caisse de dépôt et placement (CDPQ)[8] ou
d’IQ qui sont concernés. Les rémunérations de la haute direction confirment le
mouvement de convergence qui s’opère depuis près de vingt ans entre entreprises
publiques et privées. Toutefois, derrière la SAQ, Loto-Québec, la CDPQ et IQ se
dissimule l’État et sa présence change la done. Les sociétés d’État
appartiennent à l’État, la CDPQ et IQ sont des organisations constituées par
l’État. Cette filiation avec l’État ajoute une dose de complexité à la
réflexion : comment espérer atteindre
l’équilibre entre objectifs commerciaux et accomplissement d’une mission
d’intérêt général ? L’État demeure porteur de politiques publiques et
prescripteur de missions de service public, même sur le plan économique (protection
des intérêts essentiels de la Nation, protection de la santé et de l’environnement,
politique de l’emploi, action sociale, aménagement du territoire, politique des
transports, gestion du domaine public…). Or, servir l’intérêt général, dût-il
être économique, entraîne des conséquences. La Vérificatrice générale du Québec
l’a affirmé en 2019 quand elle a écrit que les rémunérations nécessitaient
l’atteinte d’un équilibre fragile[9].
Au-delà des sociétés d’État, c’est la seule présence d’une participation de
l’État dans le capital des entreprises qui fait aujourd’hui réagir le citoyen :
ce dernier s’estime personnellement propriétaire et actionnaire de celles-ci et
doit, à ce titre, contribuer à la rémunération (manque d’encaissement) ou à une
perte de l’entreprise (décaissement). Le citoyen a-t-il tort ? Pas sûr…
Des moyens d’encadrement ?
En 2019, la Vérificatrice générale
du Québec (ainsi que certaines organisations œuvrant dans le domaine de la
gouvernance d’entreprise comme l’IGOPP[10]) a
insisté dans ses recommandations sur une remise à plat de pratiques et sur la
transparence qui devait régner en matière de rémunération des hauts dirigeants
de sociétés d’État à vocation lucrative[11].
Pourtant, la régulation publique doit-elle être pour autant exclue ? N’est-elle tout simplement pas inexploitée à
l’heure actuelle ? La société d’État possède, en effet, un conseil
d’administration qui est nommé par le Gouvernement. Or, le conseil est l’entité
qui doit donner son accord pour la rémunération des dirigeants. Par conséquent,
la réévaluation du rôle du conseil est une piste à explorer. L’État dispose là
d’un moyen pour encadrer la rémunération des hauts dirigeants à condition
d’instaurer une culture de stratégie et de surveillance de la rémunération. Par
ailleurs, les « administrateurs publics » sont soumis « aux
normes d’éthique et de déontologie, y compris celles relatives à la
rémunération, édictées par règlement du gouvernement », ce qui permet de limiter
le risque attaché au phénomène de réseau entre les conseils d’administration et
les hautes directions. Mais
plus encore, conformément à l’article 27 de Loi sur la gouvernance des
sociétés d’État, le Gouvernement dispose d’un droit de délimiter le rôle du
comité des ressources humaines vis-à-vis du conseil d’administration concernant
la rémunération du P.-D.G., à « l’intérieur des paramètres fixés ». De manière
complémentaire au conseil d’administration, un renforcement de l’implication de
l’État québécois dans le processus de détermination de la rémunération doit
être sérieusement encouragé. La transparence, au centre de la politique de
rémunération au Québec, implique que l’encadrement de la rémunération des
dirigeants soit voulu par les actionnaires. Or, l’actionnaire est l’État; sa
toute puissant lui donne plein pouvoir sur la direction et sa rémunération. Il est
incertain que ces mesures suffisent. Des réformes plus radicales pourraient être adoptées
pour que le mécontentement cesse, quitte à être à contre-courant des théories
économiques traditionnelles. La France a par exemple plafonné à 450 000 €
(environ 693 000 $), part fixe
et variable incluse, la rémunération des dirigeants des entreprises publiques
françaises. Pourquoi le Québec ne s’en inspirerait-il pas, au moins pour ses
sociétés d’État à vocation commerciale ?
La rémunération des hauts dirigeants
des entreprises dans lequel l’État québécois est impliqué a besoin de retrouver
un équilibre. Le balancier est clairement en faveur d’une vision de marché,
assimilant entreprises privées et publics. C’est ce balancier qu’il faut
rééquilibrer au moyen de la régulation publique existante ou à venir. Mais
au-delà, il apparaît fondamental que les hauts dirigeants, tout comme les membres
des conseils d’administration, des sociétés d’État ou d’organisations comme la
CDPQ et IQ n’oublient pas qu’ils demeurent au service de l’intérêt général avant
d’être au service d’une logique de marché pensée au travers de profits et de
rendements. Telle demeure la raison d’être et les valeurs de ces organisations.
[1] Jean-Michel
Genois Gagnon, « La pluie de bonis se poursuit à la SAQ et chez
Loto-Québec », Le journal de Québec, 4 mai 2022. Depuis l’année financière 2016-2017, seules quatre sociétés d’État à
vocation commerciale sont autorisées à maintenir un programme de rémunération incitative,
dont Investissement Québec, Loto-Québec et la SAQ.
[2] « Legault
veut la fin des bonis mais justifie le salaire du patron de la CDPQ », La
presse, 4 mai 2022; « François Legault
prône la fin des bonis, mais pas pour le patron de la Caisse », Radio-Canada,
4mai 2022.
[3] Matthieu Zolomian, La
rémunération excessive des dirigeants de sociétés : Identification des
difficultés et voies de solution, mémoire de maîtrise, Québec, Faculté de
droit, Université Laval, 2008, aux p. 8 et s.
[4] Sylvain Larocque,
« Investissement Québec : condamnée à la médiocrité si les bonis sont
abandonnés », Le journal de Montréal, 5 mai 2022.
[5] Michel Girard, « J’en ai
marre des primes de rendement », Le journal de Montréal,
6 mai 2022.
[6] Sylvie St-Onge et
Michel Magnan, « La rémunération des dirigeants : mythes et
recommandations », Gestion, 2008, vol. 33, n° 3,
p. 25-40, à la p. 32.
[7] Vérificateur
général du Québec, «
Chapitre 3. Rémunération des hauts dirigeants », dans Rapport du Vérificateur
général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2019-2020, Québec,
mai 2019, à la p. 29, par. 100.
[8] Sylvain Larocque,
« Le grand patron de la Caisse reçoit une rémunération record », le
journal de Montréal, 28 avril 2022.
[9] Vérificateur
général du Québec, «
Chapitre 3. Rémunération des hauts dirigeants », dans Rapport du Vérificateur
général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2019-2020, Québec,
mai 2019, à la p. 3.
[10] François Desjardins, « Il faut plus de transparence sur la rémunération des
p.-d.g. de sociétés d’État, affirme l’IGOPP », Le Devoir, 3 octobre
2019.
[11] Vérificateur général du Québec, « Chapitre 3. Rémunération des hauts
dirigeants », dans Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée
nationale pour l’année 2019-2020, Québec, mai 2019.
actualités canadiennes normes de droit opinions Publications responsabilisation à l'échelle internationale Responsabilité sociale des entreprises
OPINION : Nouvelle stratégie pour l’entreprise canadienne responsable : une étape
Ivan Tchotourian 4 mai 2022 Ivan Tchotourian
Le 28 avril 2022, le gouvernement canadien a publié sa nouvelle stratégie quinquennale pour les entreprises exerçant leurs activités à l’étranger. Dénommée Conduite responsable des entreprises à l’étranger : Stratégie du Canada pour l’avenir, cette stratégie établit les priorités du gouvernement fédéral pour soutenir les entreprises canadiennes. Troisième version d’une initiative prise en 2009, cette stratégie est assurément une belle étape de franchie en faveur de l’entreprise responsable, elle impose toutefois de futures initiatives réglementaires.
Une ambition affichée
Les mots de la nouvelle
stratégie sont forts et le message envoyé par le gouvernement est porteur
d’espoir. Contrairement à sa version précédente, cette stratégie étend sa
portée en visant l’ensemble des entreprises canadiennes (peu importe leur
taille, leur secteur d’activité ou la portée de leurs activités) et pas uniquement
celles du secteur extractif. Le gouvernement souligne que : « La
conduire responsable des entreprises est une priorité pour le
Canada ». Il attend des entreprises « peu importe leur statut
juridique, leur taille, leur propriété ou leur secteur d’activité, qu’elles
contribuent au développement durable, tout en évitant les répercussions
négatives de leurs opérations et en y remédiant, et qu’elles reconnaissent que
les sociétés peuvent tirer parti de leur chaîne d’approvisionnement et de leurs
relations commerciales pour promouvoir ces valeurs ». La stratégie se
donne les moyens de ses ambitions en prévoyant une vaste panoplie d’actions qui
vont de la constitution de groupes ou de forums à l’édiction d’une norme, en
passant par l’établissement d’un fonds ou d’un réseau de champions. De manière
pertinente, la stratégie « parle » aux entreprises en insistant sur l’atténuation
des risques, la réduction des coûts et la facilitation de l’accès au capital
qu’offre une conduite responsable. Cette stratégie s’inscrit de plus dans le
débat actuel sur la vigilance dont devraient faire preuve les entreprises canadiennes
qui déploient leurs activités à l’étranger. La stratégie affirme ainsi qu’une
de ses composantes est de mettre l’accent sur la diligence raisonnable et
la responsabilisation.
Un nécessaire suivi législatif
La stratégie conserve les défauts de ses
prédécesseurs, à savoir son manque de mordants. Toutefois, cette nouvelle
mouture ouvre la porte à de possibles futures contraintes. Plusieurs déclarations
sont faites en ce sens. À propos de la diligence raisonnable par exemple, la
stratégie énonce : « En collaboration l’Office des normes générales
du Canada avec d’autres partenaires, et en complément de l’engagement du
Canada à adopter une loi pour éliminer le travail forcé des chaînes
d’approvisionnement canadiennes, le gouvernement du Canada élaborera une norme de
diligence raisonnable en matière de CRE ». « La stratégie – et le
plan d’action des activités et des outils clés qui produiront des résultats –
complète la législation actuelle et future en matière de CRE dans
de nouveaux domaines comme la diligence raisonnable dans les chaînes
d’approvisionnement ». Il faudra donc s’assurer que cette législation future
existe.
Ce
suivi est particulièrement important dans le contexte canadien. Il existe peu
de lois responsabilisant les entreprises par rapport à leurs activités à
l’étranger, ni de base législative permettant aux victimes de les poursuivre
devant les tribunaux pour leurs inconduites à l’étranger. Dans le contexte de
la vigilance, il faut se contenter des règles douanières à l’efficacité incertaine
ou de recours à des mécanismes non judiciaires de règlement des différends (PCN
et ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises) qui montrent leurs
limites et sont peu utilisés dans les faits. Deux projets de loi d’initiative
parlementaire sont actuellement débattus. Ils ne doivent pas tomber aux
oubliettes comme d’autres avant eux. Le projet de loi C-262 impose aux entreprises
opérant à l’étranger une responsabilité de prévenir, de répondre et de réparer leurs
effets négatifs sur les droits de l’Homme et l’environnement. De son côté, le
projet de loi C-263 entend répondre à la faiblesse des pouvoirs d’enquête de l’ombudsman
canadien de la responsabilité des entreprises.
Le Canada ne doit pas s’arrêter
à sa nouvelle stratégie. Les recherches montrent que la responsabilité sociale doit
être appuyée par le droit. Si
l’ambition de la stratégie est affichée, il faut qu’elle soit assumée dans une
prochaine étape. Cela passe par l’adoption de lois contraignantes. C’est à
cette condition que la stratégie atteindra ses objectifs et que les entreprises
canadiennes seront socialement responsables, loin du simple affichage. Le
Québec pourrait d’ailleurs s’inspirer de ce qui se passe à l’échelon fédéral
pour chercher à responsabiliser ses entreprises et développer ses propres outils.
Pourquoi pas une norme québécoise de vigilance ?…
autres publications Publications Responsabilité sociale des entreprises Structures juridiques
Nouvel ouvrage : The New Corporation: How « Good » Corporations Are Bad for Democracy
Ivan Tchotourian 16 septembre 2020 Ivan Tchotourian
Le professeur de UBC Joel Bakan nous gâte avec un nouvel ouvrage intitulé : « The New Corporation: How « Good » Corporations Are Bad for Democracy » (Allen Lane).
Résumé :
From the author of The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power comes this deeply informed and unflinching look at the way corporations have slyly rebranded themselves as socially conscious entities ready to tackle society’s problems, while CEO compensation soars, income inequality is at all-time highs, and democracy sits in a
precarious situation.
Over the last decade and a half, business leaders, Silicon Valley executives, and the Davos elite have been calling for a new kind of capitalism. The writing was on the wall. With income inequality soaring, wages stagnating, and a
climate crisis escalating, it was no longer viable to justify harming the environment and ducking taxes in the name of shareholder value. Business leaders realized that to get out in front of these problems, they had to make
social and environmental values the very core of their messaging. Their essential pitch was: Who could be better suited to address major societal issues than efficiently run corporations? There is just one small problem with their
doing well by doing good pitch. Corporations are still, ultimately, answerable to their shareholders, and doing well always comes first.
This essential truth lies at the heart of Joel Bakan’s argument. In lucid and engaging prose, Bakan lays bare a litany of immoral corporate actions and documents corporate power grabs dressed up as social initiatives. He makes
clear the urgency of the problem of the corporatization of society itself and shows how people are fighting back and making gains on a grassroots level.
À la prochaine…