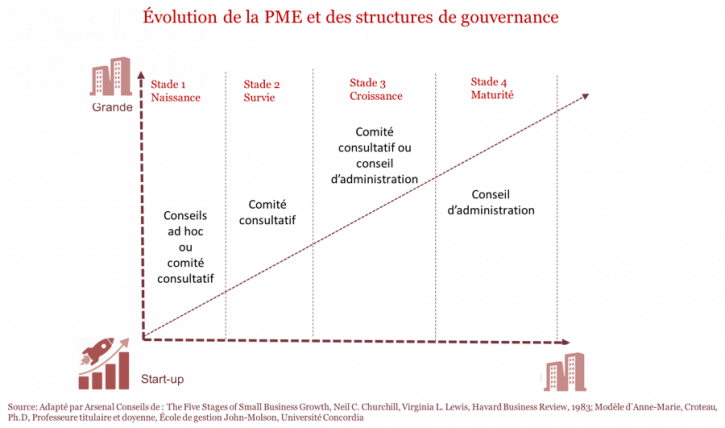Nos étudiants publient : « Les jeunes font leur place dans les CA… ou presque ! » Retour sur un article de La presse (billet de François-Olivier Picard)
Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est un billet de synthèse d’un article de presse (« Les jeunes font leur place dans les C.A », La Presse, 2017) réalisé par M. François-Olivier Picard. Ce dernier s’interroge sur la présence des jeunes dans les CA des sociétés d’État. Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.
Ivan Tchotourian
Une loi
Le 15 octobre 2017, M. Réjean Bourdeau (journaliste à la Presse) écrivait un article sur la présence des jeunes dans les conseils d’administration des Sociétés d’État au Québec : R. Bourdeau, « Les jeunes font leur place dans les C.A », La Presse, 2017. Le journaliste s’est entretenu avec Mme Sophie Tremblay, présidente de l’organisme Force Jeunesse, qui a commenté les avancées de la nouvelle Loi 693[1] adoptée à l’unanimité au mois de décembre 2016 à l’Assemblée Nationale du Québec. Cette loi modifie la Loi existante régissant les sociétés d’État québécoises et les obligera, à compter de 2021, à avoir une personne âgée de moins de 35 ans au sein de leur CA. Cette loi qui s’appliquera à 23 sociétés d’État a déjà enclenché un certain changement selon Mme Sophie Tremblay, même si la loi 693 entrera officiellement en vigueur en 2021. Ces 23 sociétés d’État comptaient uniquement deux administrateurs âgés de moins de 35 ans en 2013, on en compte aujourd’hui 8. Il reste maintenant, selon elle, à s’assurer que cette mesure de transparence dans le processus de recrutement et de formation des nouveaux administrateurs incitera le secteur privé à diversifier leur CA et qu’elle sera mise en place.
Un choix justifié
La diversité dans les instances décisionnelles est de plus en plus d’actualité. La diversité est définie comme la variété au sein des membres du CA par des aspects observables (genre, âge, nationalité) et moins tangibles comme l’éducation, les compétences et les expériences professionnelles[2]. Plusieurs études démontrent qu’au-delà de l’aspect éthique et symbolique que peut relever la diversité d’un CA, la diversité peut également augmenter les performances de l’organisation[3]. Effectivement, la créativité, une meilleure résolution des problèmes et une amélioration de la compréhension du marché produisent un avantage compétitif pour l’entreprise[4].
Des approches
Plusieurs approches sont mises en place dans le monde pour favoriser la diversité dans les instances décisionnelles. Celle choisie par le Québec, comme mentionné ci-dessus, est pour l’instant l’implantation de quotas de jeunes dans les CA… mais uniquement au niveau des Sociétés d’État provinciales. D’autres pays vont plus loin comme la Norvège ou l’Espagne qui ont voté une loi fixant à 40 % la présence féminine dans les CA[5]. De son côté, la France a instauré en 2011 une législation semblable relative à la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des conseils d’administration mieux connus sous le nom de Loi Copé-Zimmermann[6]. Cette loi mentionne que chaque société de plus de 500 salariés et ayant un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros doit détenir une proportion d’au moins 40 % d’hommes et de femmes depuis 2017[7]. Même si l’on constate que ces mesures ont fait en sorte d’accroître grandement la proportion de femmes dans les instances décisionnelles, il est important de noter qu’elles ne peuvent contrer le fait qu’on a observé depuis l’entrée en vigueur de la loi un cumul des fonctions des femmes au sein des CA et une sous-représentation de celles-ci au sein des comités spéciaux[8]. Des auteurs soulignent l’enjeu du plafond de verre qualitatif qui pourrait se substituer au plafond de verre quantitatif[9].
Se conformer ou s’expliquer au Canada
En ce qui concerne la politique du gouvernement canadien en termes de diversité aux seins des CA, celui-ci a décidé d’envisager l’approche « se confirmer ou s’expliquer ». Le Canada n’envisage pas pour le moment une réglementation contraignante. Le projet de loi C-25[10] adopté au printemps 2018 modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions et adopte une approche « se confirmer ou s’expliquer » pour favoriser la diversité dans les CA. Dans son rapport de juin 2009, l’Institut sur la Gouvernance d’Organisations Privées et Publiques[11] opte dans le même sens pour des mesures incitatives pour arriver à un taux de féminisation des conseils au-delà de 40 %. Pour l’IGGOP, « la compétence est la vertu première de tout membre de conseil. En aucun cas, les parties prenantes à une entreprise puissent croire qu’une administratrice a été qu’en raison de son genre et non pour ses qualités personnelles ». Pour le professeur Jean Bédard, titulaire de la Chaire de recherche en gouvernance de sociétés à FSA Ulaval, les exemples d’autres gouvernements ayant adopté l’approche « se conformer ou s’expliquer » semblent indiquer une augmentation de la féminisation des CA de seulement 1,5 % par année… ce qu’il considère à juste titre comme insuffisant[12]. Selon lui, la résistance au changement pourrait être une cause de l’échec de cette approche. Parmi les solutions possibles, figurent le « name and shame » instauré par la France, l’obligation faites d’établir des cibles de diversité des genres au CA des plus grandes entreprises par la Grande-Bretagne et, enfin, l’implantation de quotas comme dans les pays nordiques de l’Union.
Conclusion : et le fédéral ?
Il y a un certain consensus au sein de la communauté scientifique sur les bienfaits d’une saine diversité dans les CA. Plusieurs pays ont adopté des positions audacieuses en légiférant pour accroître la diversité dans les CA. Le Québec suit le mouvement. Le contexte étant favorable pour le gouvernement canadien avec l’étude du Projet de Loi C-25, il serait pertinent que celui-ci étudie l’option d’émettre des quotas de jeunes et de femmes dans les CA des Sociétés d’États et des grandes entreprises afin d’accélérer la transition en place vers une saine diversité.
François-Olivier Picard
Étudiant du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022
[1] Assemblée Nationale, 2016, « Loi modifiant la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État afin de favoriser la présence de jeunes au sein des conseils d’administration des sociétés d’État » [En ligne], file:///C:/Users/fopic/Downloads/16-693f.pdf.
[2] Fabrice Galia et Emmanuel Zenou, « La diversité du conseil d’administration influence-telle l’innovation ? L’impact de la diversité de genre et d’âge sur les différents types d’innovation », Revue Management & Avenir, 2013, n° 66, p. 152-181.
[3] Fabrice Galia et Emmanuel Zenou, « La diversité du conseil d’administration influence-telle l’innovation ? L’impact de la diversité de genre et d’âge sur les différents types d’innovation », Revue Management & Avenir, 2013, n° 66, p. 152-181.
[4] Fabrice Galia et Emmanuel Zenou, « La diversité du conseil d’administration influence-telle l’innovation ? L’impact de la diversité de genre et d’âge sur les différents types d’innovation », Revue Management & Avenir, 2013, n° 66, p. 152-181.
[5] Stéphane Gregoir, Tristan-Pierre Maury et Frédéric Palomino, « La féminisation des Conseils d’Administration des grandes entreprises en France : au-delà des apparences », EDHEC Business School : Pôle de recherche en économie, évaluation des politiques publiques et réforme de l’État, 2013.
[6] Legifrance, « Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle », 2011.
[7] Stéphane Gregoir, Tristan-Pierre Maury et Frédéric Palomino, « La féminisation des Conseils d’Administration des grandes entreprises en France : au-delà des apparences », EDHEC Business School : Pôle de recherche en économie, évaluation des politiques publiques et réforme de l’État, 2013.
[8] Stéphane Gregoir, Tristan-Pierre Maury et Frédéric Palomino, « La féminisation des Conseils d’Administration des grandes entreprises en France : au-delà des apparences », EDHEC Business School : Pôle de recherche en économie, évaluation des politiques publiques et réforme de l’État, 2013.
[9] Stéphane Gregoir, Tristan-Pierre Maury et Frédéric Palomino, « La féminisation des Conseils d’Administration des grandes entreprises en France : au-delà des apparences », EDHEC Business School : Pôle de recherche en économie, évaluation des politiques publiques et réforme de l’État, 2013.
[10] Parlement du Canada, « Projet de loi C-25 », Chambre des Communes du Canada, 2017.
[11] Institut sur la Gouvernance d’Organisations Privées et Publiques (IGOPP), « La place des femmes au sein des conseils d’administration : Pour faire bouger les choses », prise de position no 4, juin 2009.
[12] Jean Bédard, 2017, « Les femmes dans les conseils d’administrations », La Presse, 2017.