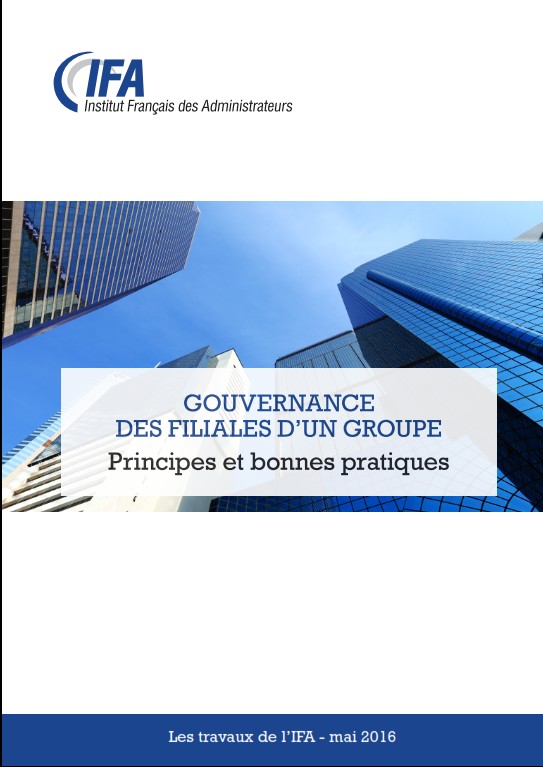Structures juridiques | Page 15
autres publications normes de droit Structures juridiques
Billet d’humeur sur Contact : L’organisation juridique de l’entreprise sociale (2 de 2)
Ivan Tchotourian 15 juillet 2016
Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier mon nouveau billet sur le blogue Contact de l’Université Laval : « L’organisation juridique de l’entreprise sociale (2 de 2) ».
Plusieurs organisations juridiques sont susceptibles de soutenir une activité marquée par une finalité environnementale ou sociale. Dans le billet précédent, nous avons présenté l’organisme de bienfaisance, l’organisme à but non lucratif et la coopérative. Je me tourne maintenant vers 2 entreprises à vocation commerciale, mais qui ont quelque chose que les autres n’ont pas: elles ne sont pas exclusivement commerciales.
Se développe aujourd’hui un nouveau type d’entreprise qui, revêtant la forme traditionnelle d’une société par actions, s’en distingue par son objet social et son respect de certains des principes particuliers. La tendance mondiale est en effet à la création de ces entreprises dites «hybrides». De plus, n’oublions pas que les entreprises commerciales traditionnelles à visée lucrative s’ouvrent à la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Comme l’affirment certains: «Social entrepreneurship: it’s for corporations too».
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
normes de droit place des salariés Structures juridiques
Information des salariés sur les opérations de cession : rappel des réformes françaises
Ivan Tchotourian 15 juillet 2016
Le décret n°2015-1811 du 23 décembre 2015 parachève l’édifice des textes relatifs à l’information des salariés en cas de vente de leur entreprise. Si des améliorations significatives ont été apportées au cadre législatif initial, certaines incertitudes subsistent quant aux modalités d’application de ce dispositif à l’efficacité pour le moins limitée. Me Pierre Bonneau (avocat associé du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre) y revient dans un billet de LEXplicite : « Information des salariés sur les opérations de cession : l’épilogue ? ».
Petit extrait :
Rappel du dispositif
Partant du constat que bon nombre d’entreprises «saines» disparaissent chaque année faute de repreneur, la loi relative à l’économie sociale et solidaire n°2014-856 du 31 juillet 2014, dite «loi Hamon» a créé deux dispositifs spécifiques :
- d’une part, une obligation triennale d’information des salariés sur les conditions d’une éventuelle cession de l’entreprise (dont le contenu vient d’être précisé par le décret n°2016-2 du 4 janvier 2016) ;
- et, d’autre part, une obligation d’information des salariés en cas de cession de fonds de commerce ou de la majorité des parts au sein d’une société de moins de 250 salariés. La loi oblige ainsi l’employeur à informer préalablement ses salariés en cas de cession de l’entreprise afin que ceux-ci puissent, le cas échéant, présenter une offre de reprise. Cette obligation se décline différemment selon que l’entreprise est ou non dotée d’un comité d’entreprise.
Ce second dispositif était le plus éloigné de l’objectif du législateur car il vise à faciliter la reprise d’entreprises par les salariés pour lesquelles un repreneur est d’ores et déjà identifié.
Pour autant, c’est celui qui a concentré les principales critiques en raison de son champ d’application très large, de sa faible sécurité juridique et de la sévérité de sa sanction, soit la nullité de la cession.
La loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 a permis la prise en compte d’une partie de ces critiques en rectifiant certains aspects du dispositif, lequel est désormais effectif au 1er janvier 2016 suite à la publication de son décret d’application le 23 décembre 2015.
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
Gouvernance Normes d'encadrement responsabilisation à l'échelle internationale Structures juridiques
IFA : quelle gouvernance des filiales d’un groupe ?
Ivan Tchotourian 11 juillet 2016
L’Institut français des administrateurs de sociétés vient de publier un document de travail sur la gouvernance des filiales d’un groupe intitulé : « Gouvernance des filiales d’un groupe ». À l’ère des multinationales et des poupées russes, ce guide sera assurément un document fort utile.
La gouvernance des groupes s’inscrit à la fois dans une logique d’intégration de plus en plus développée et dans un contexte de plus en plus complexe : multiplication des réglementations dans les différents pays dans lesquels les entreprises sont établies, demande croissante de la société civile de prise en compte des impacts sociaux et environnementaux des activités des entreprises, responsabilité pénale des multinationales ou entreprises transnationales.
La gouvernance d’une entreprise ne se limite pas au bon fonctionnement de son conseil d’administration, elle englobe également la gouvernance de l’ensemble des filiales, ce que l’on peut résumer à la « gouvernance interne » : son organisation, ses politiques et procédures ; elle s’inscrit aussi dans la culture du groupe.
Au sein d’un groupe il s’agit de faire une synthèse harmonieuse des intérêts de la société mère et des différentes filiales et participations, et notamment de faire en sorte que la vie sociale des filiales soit réelle et apporte un vrai plus au bon fonctionnement du groupe et à sa performance.
Le document formule des recommandations pour une bonne gouvernance des groupes, et pour accompagner l’administrateur siégeant dans les filiales de ces groupes.
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
Gouvernance Normes d'encadrement Structures juridiques
Gouvernance des banques : une analyse de l’ECGI
Ivan Tchotourian 9 juillet 2016
Excellent Law Working Paper de l’ECGI (No. 316/2016) de John Armour, Dan Awrey, Paul L. Davies, Luca Enriques, Jeffrey N. Gordon, Colin Mayer et Jennifer Payne consacré à la gouvernance d’entreprise des banques : « Bank Governance ».
Voici le résumé :
According to a common narrative, in addition to inadequate capital and liquidity, the failure of banks in the financial crisis also reflected their poor governance. By governance we mean broadly the oversight that comes from banks’ own shareholders and other stakeholders of the way in which they are run.
The problem of bank governance stems from the way in which banks are financed and regulated, from the externalities bank failures produce, and from the nature of their assets. In the period leading up to the financial crisis, it was believed that regulation would cause banks to internalize the costs of their activities, meaning that what maximized bank shareholders’ returns would also be in the interests of society.
Consequently large banks used the same governance tools as non-financial companies to minimize shareholder-management agency costs, namely independent boards, shareholder rights, the shareholder primacy norm, the threat of takeovers, and equity-based executive compensation. Unfortunately, such tools had the adverse effect of encouraging bank managers to take excessive risks: as we describe in this chapter, banks that had the most ‘pro-shareholder’ boards and the closest alignment between executive returns and the stock price were those which took the most risks prior to, and suffered the greatest losses during, the crisis.
Consequently, a significant rethink about the way in which banks are governed is required. The structure and function of bank boards, the compensation of bank executives and the function of risk management within organizations needs careful crafting if governance reforms are to address not exacerbate bank failures.
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
autres publications engagement et activisme actionnarial place des salariés Structures juridiques
Qui est propriétaire de l’entreprise ?
Ivan Tchotourian 8 juillet 2016
C’est à cette question que s’attaquent Virgile Chassagnon et Xavier Hollandts dans un article intitulé : « Who are the owners of the firm: shareholders, employees or no one? » (Journal of Institutional Economics, 2014, Vo. 10, pp 47-69).
Voici le résumé :
The issue of firm ownership is an ongoing debate. For several decades, contractarian theory has undoubtedly shaped the academic debate in both law and economics. Proponents of this approach suggest that shareholders can legitimately be considered the owners of a firm because they hold shares. This approach, though attractive, is legally incorrect. Legal scholars have noted that a corporation cannot legally belong to shareholders or other stakeholders; no one owns the firm (and a corporation). The question of firm ownership masks the following crucial issue: Who should govern the firm? In this article, after returning to the theoretical debate on firm ownership and explaining why a firm cannot be owned, we shall analyze power as the core of firm governance. This approach is a potentially relevant and accurate way to address the problems of specific human investment, collective creation and productive (consummate) cooperation in modern firms.
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
normes de droit Structures juridiques
Billet d’humeur sur Contact : quelle organisation juridique pour l’entreprise sociale au Canada ?
Ivan Tchotourian 5 juillet 2016
1er des 2 billets que je consacre sur le blogue Contact à l’entreprise sociale au Canada : « L’organisation juridique de l’entreprise sociale (1 de 2) ». Eu égard à l’actualité de ce thème et à la volonté croissante des entrepreneurs d’allier réussite économique et réussite sociétal, je fais une synthèse des diverses structures existantes au Canada.
Un mouvement général en pleine croissance. C’est ainsi que le Forum économique mondial qualifie l’entreprise sociale: «[…] social entrepreneurship is a growing global movement». Économiquement, ces entreprises s’inscrivent dans une logique de marché, et une part significative de leurs ressources provient de la vente des biens ou des services qu’ils produisent. Mais, elles se définissent surtout par la finalité sociale, sociétale ou environnementale de leur action, ainsi que par un principe de recherche limitée de profit. Ces entreprises vont d’organismes de bienfaisance aux commerces soucieux de leur incidence sociale, en passant par les coopératives. (…) Ce billet en 2 parties désire apporter un éclairage sur l’entreprise sociale avec l’interrogation suivante en toile de fond: quel choix le droit offre-t-il aux entrepreneurs désireux d’œuvrer au bénéfice de l’environnement, de leur communauté ou de la société en général?
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
objectifs de l'entreprise Structures juridiques Valeur actionnariale vs. sociétale
Des entreprises progressistes… vraiment ?
Ivan Tchotourian 27 juin 2016
« Faire de l’entreprise un bien commun » ? 18% des dirigeants d’entreprise annoncent aujourd’hui cet objectif comme prioritaire, selon le récent sondage réalisé par Opinion Way pour l’association Entreprise et Progrès et Generali * sur le thème « Les entreprises françaises sont-elles progressistes ? ».
L’enquête qui se penche sur l’évolution de l’implication des chefs d’entreprise en matière de RSE met aussi en relief un décalage entre deux perceptions : quand 89% des dirigeants estiment devoir placer l’impact sociétal de leur activité au même plan que la performance économique, les Français interrogés jugent _ quasiment dans les mêmes proportions (81%) _ que l’entreprise… reste uniquement tournée vers la rentabilité.
Pour celles et ceux que le mouvement progressistes intéressent, plusieurs juristes de renom s’y intéressent :
- Claude Champaud, dir, L’entreprise dans la société du 21e siècle, Bruxelles, Larcier, 2013; Claude Champaud, Manifeste pour la doctrine de l’entreprise : Sortir de la crise du financialisme, Bruxelles, Larcier, 2011.
- Isabelle Corbisier, « L’entreprise : Quelles sont ses valeurs fondatrices et ses finalités ? » dans Nicolas Thirion, dir, Crise et droit économique, Bruxelles, Larcier, 2014, 175 et aussi Isabelle Corbisier, La société : contrat ou institution ? Droits étatsuniens, français, belge, néerlandais, allemand et luxembourgeois, Bruxelles, Larcier, 2011.
- Simon Deakin, « The Juridical Nature of the Firm » dans Thomas Clarke et Douglas Branson, dir, The SAGE Handbook of Corporate Governance, Londres, SAGE, 2012, 113.
- Kent Greenfield, « Saving the World With Corporate Law » (2008) 57 Emory LJ 947; Kent Greenfield, « New Principles for Corporate Law » (2005) 1 Hastings Bus LJ 87.
- Andrew R Keay, The Corporate Objective: Corporations, Globalisation and the Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2013.
- Catherine Malecki, Responsabilité sociale des entreprises : Perspectives de la gouvernance d’entreprise durable, Paris, LGDJ, 2014.
- David K Millon, « Why Is Corporate Management Obsessed with Quarterly Earnings and What Should be Done About It? » (2002) 70 Geo Wash L Rev. 890; David K Millon, « New Directions in Corporate Law: Communitarians, Contractarians, and Theorisis in Corporate Law » (1993) 50 Wash. & Lee L Rev 1373 ; David K Millon, « Redefining Corporate Law » (1991) 24 Ind L Rev 233; David K Millon, « Theories of the Corporation » (1990) 39 Duke LJ 201.
- Lawrence E Mitchell, Corporate Irresponsibility: America’s Newest Export, New Haven, Yale University Press, 2001 ; Lawrence E Mitchell, dir, Progressive Corporate Law, Boulder, Westview Press, 1995.
- Beate Sjåfjell et Benjamin Richardson, Company Law and Sustainability: Legal Barriers and Opportunities, New York, Cambridge University Press, 2015 et Beate Sjåfjell, Towards A Sustainable EU Company Law: A Normative Analysis of the Objectives of EU Law, with the Takeover Directive as a Test Case, European Company Law Series, Kluwer Law International, 2009.
- Lynn A Stout, The Shareholder Value Myth, San Francisco, Berrett-Koehler, 2012 ; Lynn A Stout, « Why We Should Stop Teaching Dodge v. Ford » (2008) 3:1 Va L & Bus Rev 163 ; Lynn A Stout, « Takeovers in the Ivory Tower: How Academics Are Learning Martin Lipton May be Right » (2005) 60 Bus Lawyer 1435 ; Lynn A Stout, « Share price as a Poor Criterion for Good Corporate Law » (2005) UCLA School of Law Document de travail No 05-7, en ligne: <http://papers.ssrn.com/abstract=660622> ; Lynn A Stout, « Bad and Not-So-Bad Arguments for Shareholder Primacy » (2002) 75:5 S Cal L Rev 1189.
- Alain Supiot, La gouvernance par les nombres, Paris, Éditions Fayard, 2015 ; Alain Supiot, dir, L’entreprise dans un monde sans frontières – Perspectives économiques et juridiques, Collection les sens du droit, Paris, Éditions Dalloz, 2015.
À la prochaine…
Ivan Tchotourian