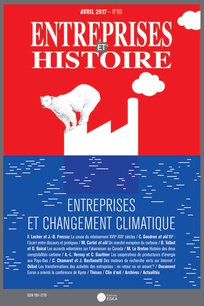Gouvernance | Page 47
Gouvernance parties prenantes Responsabilité sociale des entreprises
Vers un capitalisme des parties prenantes
Ivan Tchotourian 24 avril 2020 Ivan Tchotourian
Klaus Schwab (fondateur et le président exécutif du Forum économique mondial, dit Forum de Davos) vient de publier une belle tribune dans FigaroVox : « La crise économique liée au Covid-19: une épreuve de vérité pour les principes qui guident les dirigeants des grandes entreprises » (26 mars 2020).
Extrait :
Alors que l’urgence sanitaire mondiale Covid-19 se poursuit, les retombées économiques se multiplient. La croissance économique mondiale s’est inversée, les entreprises ont commencé à annuler les services qu’elles assurent à leurs clients et des millions de personnes sont au chômage technique ou licenciées. On peut se demander ce qu’est devenu le «capitalisme des parties prenantes» [capitalisme inclusif, NDLR], le modèle économique éclairé auquel de nombreuses entreprises ont adhéré il y a quelques mois à peine. Comment peut-on le rapprocher de ce que nous voyons aujourd’hui?
Avant de répondre à cette question, rappelons ce qu’est le «capitalisme des parties prenantes»: il s’agit d’assurer la préservation et la résilience à long terme de l’entreprise, et son ancrage dans la société. De ce point de vue, une crise économique à court terme, comme celle déclenchée par le Covid-19, permet de distinguer les entreprises qui incarnent véritablement le «modèle des parties prenantes» de celles qui ne lui ont accordé qu’un intérêt de pure forme, tout en conservant fondamentalement une orientation de profit à court terme.Une organisation orientée vers les parties prenantes s’efforcerait de maintenir ses compétences de base.
Cela s’applique à toutes les organisations. Le Forum Économique Mondial est lui aussi confronté à la question de savoir quoi faire des équipes qui sont temporairement «en chômage technique» en raison de l’annulation d’événements physiques. Une organisation orientée vers les actionnaires réduirait immédiatement ses effectifs, afin de maintenir la rentabilité à court terme. Mais une organisation orientée vers les parties prenantes s’efforcerait de maintenir ses compétences de base, de conserver ses talents et d’accepter les coûts à court terme pour préserver sa résilience à long terme.
Nous avons la chance de pouvoir choisir cette dernière voie. Pendant de nombreuses années en tant que fondateur et président exécutif du Forum Économique Mondial, ni moi ni les autres membres du conseil d’administration n’avons demandé ou reçu une augmentation de salaire ou une prime à court terme basée sur les performances, malgré une augmentation constante de la taille et des revenus de l’organisation. D’ailleurs, le Forum Économique Mondial a supprimé les bonus il y a deux ans. Les salariés doivent être motivés par l’objectif et non par l’argent.
Cette approche fait que notre organisation n’est pas obligée de recourir à des licenciements immédiats ou de diminuer son offre à ses membres. Au contraire, ces dernières semaines, nous avons mis en place une offre virtuelle, et nous avons réuni nos partenaires mondiaux pour des réunions et des échanges de bonnes pratiques au sujet du Covid-19. Nous avons aussi mis en place un groupe de travail pour soutenir la réponse sanitaire de l’Organisation mondiale de la santé et pour aider à assurer la continuité des activités tout en protégeant les vies et les moyens de subsistance des salariés.
Il en va de même ailleurs. La crise du Covid-19 révèle ceux qui ne pratiquent pas le «capitalisme des parties prenantes» tout en faisant mine de l’approuver. Bien sûr, presque toutes les entreprises mondiales sont profondément secouées par le Covid-19, et beaucoup ont dû recourir à des mesures très douloureuses, sans que ce soit de leur faute. Mais les différences entre les entreprises qui ont réellement orienté leur activité vers le modèle des parties prenantes et celles qui avaient un modèle d’actionnariat à court terme sont parfois frappantes.
Certaines entreprises ont utilisé leurs bénéfices croissants des années précédentes pour mener des programmes de rachat d’actions importants. Cela a stimulé leur rentabilité à court terme et augmenté artificiellement les bonus distribués aux cadres. Mais, confrontées au manque de réserves ou d’investissements stratégiques, nombre de ces entreprises sont aujourd’hui les premières à souffrir, incapables de redresser la situation sans intervention du gouvernement. En revanche, les entreprises qui ont utilisé leurs bénéfices pour investir dans la transformation numérique, le talent et la recherche et développement font souvent preuve d’une capacité de réaction qui fait défaut aux autres.De nombreuses entreprises qui ont adopté le modèle des parties prenantes ont déjà réagi en offrant leur aide pendant cette crise.
Ces dernières semaines, certaines entreprises ont continué à annoncer des bonus record pour leur PDG, calculés sur la rentabilité et le cours des actions de l’année fiscale 2019. Leurs clients et leurs salariés, dont beaucoup souffrent, n’oublieront pas des décisions aussi éloignées de la réalité qu’ils vivent. En revanche, le Directeur général de Marriot, Arne Sorenson, dont l’entreprise et les salariés ont été sévèrement touchés, a annoncé que le président et lui ne toucheraient aucun salaire en 2020 et réduiraient de moitié la rémunération de l’équipe dirigeante. Ainsi a-t-il illustré la capacité de son entreprise à faire corps avec ses salariés et les sociétés où elle opère.
Enfin, de nombreuses entreprises qui ont adopté le modèle des parties prenantes ont déjà réagi en offrant leur aide pendant cette crise. Unilever, qui est un champion du modèle des parties prenantes depuis le mandat de Paul Polman, a annoncé le 23 mars un don immédiat de 50 millions de dollars en savon à la plateforme d’action Covid qui a été mise en place en réponse à l’urgence sanitaire mondiale. Le géant du transport maritime Maersk offre ses navires et son espace de chargement pour acheminer des fournitures d’urgence partout où elles sont nécessaires dans le monde.
Ces entreprises comprennent qu’une urgence sanitaire mondiale comme celle du Covid-19 exige que tous les acteurs de la société se réorientent temporairement vers l’urgence, et elles ont l’agilité et la préparation nécessaires pour le faire. Ce n’est pas une coïncidence. Ce sont les mêmes entreprises qui ont optimisé la prospérité à long terme et cultivé le capitalisme des actionnaires. Pendant cette période, et lorsque tout cela sera terminé, nous devons soutenir ces entreprises. Elles mettent en œuvre le modèle économique qui nous permettra de survivre aujourd’hui et de prospérer à nouveau demain.
À la prochaine…
actualités internationales Gouvernance normes de droit Nouvelles diverses
Une incorporation aux Pays-Bas vous tente ?
Ivan Tchotourian 24 avril 2020 Ivan Tchotourian
Plusieurs entreprises européennes ont choisi de s’immatriculer aux Pays-Bas plutôt que dans leur pays d’origine. Pourquoi ce choix ? Mme Laurence Boisseau fournit un bel éclairage dans l’article suivant : « Siège social aux Pays-Bas : les risques pour les actionnaires » (Les Échos.fr, novembre 2019).
Extrait :
Actions à droit de vote multiple
La différence la plus sensible réside dans les actions à droit de vote multiple, qui sont autorisées aux Pays-Bas et pas en France. Dans l’Hexagone, seuls des droits de vote double sont possibles. Aux Pays-Bas existent différentes catégories d’actions, sans aucune limite sur les droits de vote. Cela permet de verrouiller un capital et donc de protéger une entreprise contre une tentative de prise de contrôle.
Autre point, moins favorable aux actionnaires, le seuil à partir duquel il est possible de déposer des résolutions aux assemblées générales. Aux Pays-Bas, il faut avoir rassemblé 3 % du capital, en France, seulement 0,5 %. Et c’est déjà beaucoup, se plaignent certains représentants de fonds. Pour déposer une résolution chez Total, cela suppose d’avoir investi plusieurs centaines de millions d’euros. En revanche, les résolutions sont votées avec les mêmes majorités, simples la plupart du temps. La majorité qualifiée, soit 66 %, concerne des modifications de statuts.
Salaires des patrons
Les salaires des patrons sont en revanche scrutés de plus près en France. Pour l’instant, seule la politique de rémunération est soumise au vote des actionnaires néerlandais. Mais, en 2020, la donne sera différente car les Pays-Bas auront transposé la directive des actionnaires. L’assemblée générale votera donc les rémunérations individuelles des dirigeants, avec un vote consultatif. En France, ce vote est devenu contraignant avec la loi Sapin II suite à l’affaire Renault.
Les minoritaires sont mieux traités aux Pays-Bas en matière de retrait de la cote : le seuil à partir duquel une société peut être retirée est de 95 % aux Pays-Bas contre 90 % en France depuis la loi Pacte. Il est donc plus favorable aux minoritaires dans le premier cas.
Enfin, les Pays Bas offrent un cadre plus accueillant aux « class actions », ces actions collectives en justice par lesquelles des actionnaires peuvent demander des comptes à des entreprises. Dans certaines affaires, des plaignants ont obtenu des sommes importantes. En 2007, la justice a accordé 1,37 milliard d’euros à près de 300.000 actionnaires de la banque franco-belge Dexia, en lien avec l’effondrement du cours de Bourse en 2001. En France, les « class actions » n’existent pas pour les affaires concernant la Bourse.
À la prochaine…
Gouvernance mission et composition du conseil d'administration Normes d'encadrement
L’après-COVID-19 : à quoi devront penser les CA ?
Ivan Tchotourian 24 avril 2020 Ivan Tchotourian
Très intéressant billet de blogue du cabient Langlois portant sur la gouvernance d’entreprise et les CA dans l’après-COVID-19 : « L’après-COVID-19 : les administrateurs face à une nouvelle gamme de risques propres au XXIe siècle ». Merci à Mes Brizard, Ferron et François Larouche…
Extrait :
En revanche, qu’ils soient évitables ou non, plusieurs de ces risques sont prévisibles. Il appartient donc à la direction, mais également aux cadres de sociétés, de penser à l’avenir post-COVID-19 pour que leur organisation en tire avantage à long terme.
Déterminer et évaluer les nouveaux risques
Dans ce contexte, l’examen des nouveaux risques devient fondamental pour assurer la continuité des affaires lors d’une crise et la pérennité de l’organisation dans le temps.
Cela consiste à déterminer et évaluer chaque étape de la trajectoire d’un risque potentiel. Ainsi, des origines d’un danger à ses conséquences finales pour une organisation, cette analyse est essentielle pour décider si et comment le risque doit être évité, réduit ou accepté2.
Or, il existe certaines difficultés à évaluer les risques, notamment parce que ce travail d’évaluation nécessite la mobilisation d’une grande quantité de connaissances provenant de diverses disciplines, ainsi que l’élaboration de méthodologies et d’outils sophistiqués et de plus en plus fiables3.
Promouvoir une culture de sécurité à l’égard des risques au sein des organisations
Le succès ou l’échec d’une organisation dans la gestion des risques ne dépend pas seulement des mesures spécifiques de prévention et d’atténuation, mais aussi de la force de sa « culture de sécurité », de ses attitudes envers le risque et la sécurité à tous les niveaux de prise de décision4.
Dans ce contexte, il devient donc pertinent d’instaurer au sein de l’organisation une culture de sécurité à l’égard des risques. Les administrateurs sont par ailleurs bien placés pour insuffler cette culture, en la développant d’abord au sein du conseil d’administration et dans ses relations avec la direction de la société.
Au niveau du conseil d’administration, la création d’un comité sur la prospective et la gestion du risque peut être une bonne pratique à mettre en œuvre afin de s’assurer que le conseil dans son ensemble s’inspire des meilleures pratiques et des derniers développements en la matière.
En outre, un conseil d’administration composé de membres qualifiés, dont les profils sont variés offrira une meilleure pluridisciplinarité dans le travail d’évaluation des risques. Ainsi, la parité, la diversité ethnique et culturelle, la jeunesse, l’horizon professionnel varié des membres d’un conseil d’administration sont autant d’atouts pour ce travail holistique. L’assistance d’experts dans ce domaine peut également aider la direction et le conseil à étendre leur réflexion au-delà de ce qui est bien connu et déjà anticipé, pour s’assurer d’une vue plus globale5.
Préparer l’avenir
Dans les paragraphes qui suivent, sans nous vouloir exhaustifs, nous examinerons certains des risques mondiaux de 2020 et esquisserons une nouvelle gamme de risques post-COVID-19. D’une forte tendance en faveur de la mondialisation, les nouvelles circonstances imposent de nouvelles réflexions sur l’avenir de notre économie dont plusieurs secteurs misaient sur les chaînes d’approvisionnements mondiales et les exportations.
1) Paysage des risques mondiaux 2020 (pré-COVID-19)6
Dans son rapport sur les risques mondiaux 2020, le Forum économique mondial (FEM) décrivait un monde instable en offrant une perspective riche sur les principales menaces susceptibles d’avoir un effet sur la prospérité mondiale en 2020 et au cours des dix prochaines années. Le rapport 2020 proposait aux parties prenantes de trouver des moyens pour agir rapidement et considérer les impacts des risques suivants :
- Risques écologiques
- Pollution de l’air
- Perte de la biodiversité
- Changements climatiques
- Séismes et éruptions volcaniques
- Inondations
- Tempêtes et cyclones
- Gouvernance des océans et des pôles
- Vagues de chaleurs extrêmes
- Risques technologiques
- Panne des infrastructures informatiques
- Sécurité des données et information en ligne
- Menaces liées aux nouvelles technologies
- Cyberattaques
- Risques économiques
- Effondrement du prix des actifs
- Fluctuation extrême des matières premières
- Fluctuations extrêmes des prix à la consommation
- Fluctuations extrêmes des prix des ressources énergétiques
- Crises budgétaires
- Déséquilibres commerciaux et volatilité des infrastructures
- Pénurie des liquidités/assèchement des crédits
- Défaillance des instances de régulation
- Retraits de la mondialisation
- Ralentissement de l’économie chinoise
- Risques politiques et géopolitiques
- Polarisation politique et populisme
- Fragilité des États
- Conflits géopolitiques
- Défaillances en matière de gouvernance mondiale
- Commerce illicite
- Crime organisé
- Sécurité de l’espace
- Terrorisme
- Armes de destruction massive
- Crise de la confiance publique
- Risques sociaux et sanitaires
- Maladies chroniques et infectieuses
- Défis démographiques
- Disparités économiques
- Sécurité alimentaire
- Migrations
- Sécurité d’approvisionnement en eau
- Risques liés à l’éthique
- Manque de transparence et de loyauté de la direction et des administrateurs
- Délits d’initiés
- Abus de pouvoir
- Conflits d’intérêts
- Corruption
- Culture de la performance à outrance
2) Esquisse de la nouvelle gamme de risques post-COVID-19
Passées les premières semaines de la crise sanitaire mondiale sans précédent liées à la COVID-19, il est maintenant plus que pertinent de se questionner sur l’après-crise, dans un contexte mondial en plein changement. Quels sont les nouveaux risques générés par la crise actuelle?
La banque d’investissements Natixis annonçait récemment dans une note aux investisseurs la possibilité de la fin du capitalisme néo-libéral comme modèle du capitalisme7. Ce facteur de risque semble être l’un des plus déterminants à l’heure actuelle, car ce système économique reposait notamment sur la mondialisation, la réduction du rôle de l’État et de la pression fiscale, les privatisations et, dans certains pays, la faiblesse de la protection sociale.
Dans cette note, Natixis avance que la crise de la COVID-19 pourrait certainement provoquer :
- un retour à des chaînes de valeur régionale, au lieu de chaînes de valeur mondiale, dans un nouveau contexte de démondialisation des économies réelles;
- une hausse des dépenses publiques en santé, des indemnisations du chômage, du soutien aux entreprises et la fin de la rigueur budgétaire là où elle était installée, puis la fin de la concurrence fiscale, car les États seront à la recherche de recettes;
- un nouveau désir d’intervention de l’État pour définir et développer les industries stratégiques locales (pharmacie, nouvelles technologies, énergies renouvelables, alimentaires, défense)8.
Comme évoqué dans notre dernier article, la gouvernance d’entreprise ne s’inscrit plus en fonction de la seule maximisation des profits pour les actionnaires, mais à partir des processus décisionnels qui tiennent compte des différentes parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs, sous-traitants, société civile en général)9.
Les attentes croissantes des parties prenantes en matière d’éthique rejoignent les préoccupations des entreprises à assumer leur responsabilité sociétale et incitent maintenant les cadres et conseil d’administration, à une approche proactive sur ces sujets.
Pour les membres du conseil d’administration, l’évaluation des risques éthiques va beaucoup plus loin que la simple évaluation des enjeux de conformité (éthique de conformité). Il appartient au conseil de s’assurer que les véritables risques éthiques de l’organisation soient identifiés et analysés. Cette réflexion est d’autant plus importante dans le contexte de cette pause forcée. Le philosophe et sociologue Bruno Dufour nous invite à utiliser ce temps de confinement pour faire un inventaire des activités à réévaluer et nous fournit un outil pour ce faire10.
La norme internationale ISO 26000 : une référence en matière de gouvernance éthique
En 2010, l’Organisation internationale de normalisation (ISO) a élaboré la norme ISO 26000 qui dresse les principales lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale d’une organisation et vise à encourager les organisations à surpasser les exigences de la loi, notamment en intégrant des comportements éthiques et socialement responsables.
Ainsi, les Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale placent la gouvernance en partie responsable de l’optimisation de la contribution de l’organisation. Sont donc pris en compte les considérations relatives au développement durable et au respect des droits de la personne, au respect des relations de travail, de l’environnement, des pratiques exemptes de corruption, des questions relatives aux consommateurs et des liens avec les communautés et du développement local11.
L’assistance d’experts dans ce domaine peut également aider les dirigeants et les administrateurs à étendre leur réflexion au-delà de ce qui est bien connu et déjà anticipé, pour s’assurer d’une vue plus globale.
À la prochaine…
Gouvernance Normes d'encadrement Responsabilité sociale des entreprises
Un peu de lecture sur le changement climatique
Ivan Tchotourian 24 avril 2020 Ivan Tchotourian
Curieux de savoir les rapports qu’entretiennent les entreprises et le changement climatique ? Je vous invite à lire ce numéro spécial de la revue Entreprises et histoire : « Entreprises et changement climatique » (2017/1 (n° 86)).
Extrait de l’introduction :
En 1999 paraissait un numéro spécial de la Business History Review consacré aux entreprises et l’environnement. Dans leur article introductif , Christine Meisner Rosen et Christopher Sellers observaient que les historiens des entreprises s’étaient peu préoccupés des problèmes environnementaux, notamment des conséquences sur l’environnement des activités industrielles et manufacturières. Ils avaient préféré se focaliser, dans la perspective ouverte par Alfred Chandler, sur les dynamiques des stratégies d’entreprise et sur l’évolution interne des entreprises.
2Dix ans plus tard, le constat n’avait pas fondamentalement changé. Dans un éditorial programmatique sur l’avenir de la même revue, Walter Friedman et Geoffrey Jones faisaient un constat similaire. Parmi les axes de recherche futurs identifiés, ils estimaient qu’il était « surprenant que les historiens des entreprises n’aient pas porté davantage d’attention aux questions de durabilité, étant donné que les actions des entreprises ont été les premières causes de la dégradation de l’environnement et du changement climatique au cours de ces deux derniers siècles » (notre traduction).
À cet égard, Entreprises et Histoire a été précurseur dans l’exploration des questions environnementales et de durabilité au regard des entreprises. Il y a dix ans paraissait un numéro d’Entreprises et Histoire sur les entreprises et le développement durable. L’éditorial de ce numéro s’interrogeait sur les conditions d’une recherche historique sur un thème d’actualité, empreint de considérations éthiques, morales et politiques et dont les contours demeurent flous. L’émergence d’une question d’actualité suffit-elle à en faire un objet de recherche sur le plan historique, se demandaient les auteurs ? La notion n’était-elle pas trop galvaudée, saturée de discours et d’interprétations pour permettre la prise de recul nécessaire ? Ils soulignaient également les impasses de la littérature en sciences sociales sur le sujet. Celle-ci avait tendance à étudier les problématiques du développement durable dans l’entreprise et de la responsabilité sociale (RSE) à travers un prisme universel et anhistorique, à partir d’une conception essentialisée des rapports de l’entreprise avec ses parties prenantes.
Dès lors, dans quels termes poser des questions de recherche adaptées à une démarche historique ? Pour y parvenir, ils proposaient trois éléments de méthode. Premier élément : laisser de côté la question de la nature de l’entreprise pour s’intéresser à ses projets et à ses rationalisations successives. Deuxième élément : non pas considérer les stratégies des entreprises et les régulations publiques comme deux champs séparés mais s’intéresser à leurs conditionnements réciproques et aux processus de régulation conjointe entre entreprise et société. Troisième élément : dépasser la seule analyse des discours managériaux pour étudier les pratiques des entreprises, notamment les plus innovantes. Dans cette perspective, les auteurs suggéraient, d’une part, d’étudier l’organisation et les outils de gestion du développement durable dans les entreprises et, d’autre part, d’analyser à quelles conditions le développement durable pouvait constituer un nouveau champ d’innovation pour les entreprises.
Pour étudier la mise à l’agenda stratégique du développement durable et de la RSE dans les entreprises, les auteurs s’étaient livrés à une généalogie des concepts et des pratiques afin d’identifier comment un projet politique, puis un projet managérial du développement s’étaient constitués au tournant des années 1980 et 1990, en montrant les ruptures qu’ils introduisaient par rapport à des formes plus anciennes de stratégies et politiques environnementales.
À la prochaine…
Base documentaire doctrine engagement et activisme actionnarial Gouvernance
Une démocratie actionnariale au rabais ?
Ivan Tchotourian 24 avril 2020 Ivan Tchotourian
Selon le journaliste Martin Vallières de La presse, « les assemblées annuelles en mode virtuel inquiètent les tenants des droits des actionnaires » (21 avril 2020). S’il soulève une question intéressante à laquelle Yvan Allaire apporte un bel éclairage, la vraie question est de se demander s’il y a le choix ? Ce qui m’inquiète plutôt est le futur : cette manière de faire restera-t-elle ? Espérons que non…
Extrait :
« Depuis un bon moment, avant la crise de la COVID-19, certaines entreprises souhaitaient passer à des assemblées d’actionnaires virtuelles en tout ou en partie, en combinant temporairement leur assemblée en personne et en mode virtuel », constate Yvan Allaire, président exécutif de l’Institut sur la gouvernance des organisations publiques et privées (IGOPP).
« La crise de pandémie fournit l’occasion pour les entreprises de tester ce modèle d’assemblée virtuelle en circonstances exceptionnelles. Mais il n’en demeure pas moins que de telles assemblées ne donneront pas pleinement satisfaction aux petits actionnaires. Et pendant que les grands fonds [d’investissement] conservent leurs autres moyens d’accès aux dirigeants et administrateurs des entreprises. »
Expérience troublante
Selon Yvan Allaire, la toute récente expérience des premières assemblées virtuelles parmi les banques canadiennes a mis en lumière les défis à surmonter.
« Si l’on s’en remet aux pratiques mises en place par les banques lors de leurs assemblées en ligne, notamment la transmission d’avance par écrit des questions d’actionnaires pour lecture et réponse durant l’assemblée, c’est bien difficile dans ce contexte pour un actionnaire de demander plus de précision, de contredire la réponse qu’on lui a apportée ou d’indiquer son insatisfaction. »
Du point de vue de Willie Gagnon, directeur du regroupement québécois d’actionnaires militants MEDAC, « si la tenue d’assemblées d’actionnaires en mode virtuel devait perdurer après cette crise de pandémie, on espère que ce qui vient de se passer lors des premières assemblées virtuelles parmi les banques canadiennes ne deviendra pas la norme parmi les autres entreprises influentes en Bourse ».
« Depuis le début d’avril, le MEDAC a participé aux assemblées virtuelles des banques où il détient des actions titres et où il avait soumis une proposition d’actionnaire dûment inscrite dans chacune des circulaires », relate-t-il à La Presse.
« Néanmoins, la conduite très contrôlée de ces assemblées virtuelles a fait que nous n’avons pas eu notre droit de parole habituel pour présenter notre proposition. Et les autres actionnaires ont été réduits à communiquer par écrit leurs interventions qui étaient ensuite lues et commentées par des représentants et des dirigeants de chaque banque. »
L’après-pandémie ?
« La tenue d’une assemblée en mode virtuel ou en ligne plutôt qu’en personne est une précaution raisonnable en crise de pandémie. Cela dit, est-ce que les nombreuses entreprises qui tiendront une assemblée virtuelle pour la première fois donneront à leurs actionnaires les mêmes possibilités d’y participer que s’ils étaient physiquement présents, y compris la possibilité de poser des questions et d’engager le dialogue ? » s’inquiète Kevin Thomas, chef de la direction de l’association SHARE, spécialisée en formation et recherche en droits des actionnaires.
Par ailleurs, « une fois passée la crise de pandémie, plusieurs entreprises voudront sans doute continuer à tenir leurs assemblées d’actionnaires de façon virtuelle et en ligne ».
Toutefois, souligne-t-il à La Presse, « les récentes assemblées virtuelles des banques ont révélé des indices troublants sur la façon dont les droits des actionnaires pourraient être restreints. Par conséquent, nous attendons des entreprises qu’elles s’engagent explicitement à tenir à nouveau leurs assemblées en personne lorsque les préoccupations de santé publique le permettront ».
« Entre-temps, si nous devions constater que des entreprises utilisent délibérément la tenue de leur assemblée en mode virtuel pour restreindre l’accès et la pleine participation de leurs actionnaires, avertit Kevin Thomas, les membres de SHARE se mobiliseraient pour voter contre tous les administrateurs de ces entreprises à la prochaine occasion. »
Base documentaire Gouvernance loi et réglementation mission et composition du conseil d'administration
COVID-19 : des CA et des dirigeants à risque de recours judiciaires ?
Ivan Tchotourian 23 avril 2020 Ivan Tchotourian
The Canadien Underwriter propose dans un article paru le 22 avril 2020 un bel article dans le contexte du COVID-19 : « Liability claims that could arise from the pandemic ». Des recours judiciaires en perspective contre les CA et les directions ?
Extrait :
One result of the ongoing COVID-19 pandemic will be liability claims against company boards, property and casualty industry watchers predict.
“I think we will see litigation coming out of this,” Shara Roy, a partner with law firm Lenczner Slaght Royce Smith Griffin LLP, which defends publicly traded companies in class action lawsuits.
Publicly-traded firms have been sued in the past after share prices dropped as a result of what Roy calls “external factors.”
With the pandemic, there could be allegations that boards of directors did not have proper governance or risk management practices, said Jim Auden, Chicago-based managing director of North American Insurance at Fitch Ratings, in an interview Tuesday.
Corporate clients – as well as their directors and officers – are exposed to misrepresentation lawsuits if the company’s share price drops. Usually what happens is shareholders allege a company, as well as individual directors and officers, had misrepresented the financial health of the firm.
In the case of COVID-19, clients could defend themselves by referring to statements they made in securities filings before the outbreak, Roy said in an interview about stock market fluctuations during the first quarter of 2020. This depends on exactly what those firms said in those filings (such as management discussion and analysis) before the outbreak of the COVID-19 virus.
“If they do address it, it has to be specific,” said Roy. “It cannot be boilerplate and it needs to deal with the impact on their business directly.”
That said, publicly traded firms are not generally required to interpret the external, political, economic and social developments on their own finances, Roy said, quoting guidance from the Canadian Securities Administrators.
What could hurt the client’s directors and officers is if they told the financial markets they were well-prepared for this type of crisis.
À la prochaine…
engagement et activisme actionnarial Gouvernance Normes d'encadrement normes de droit
The Law and Practice of Shareholder Inspection Rights: A Comparative Analysis of China and the U.S.
Ivan Tchotourian 23 avril 2020 Ivan Tchotourian
Une belle comparaison entre les droits étatsuniens et chinois à propos des droits d’inspection des actionnaires dans : R. Huang et R. Thomas, « The Law and Practice of Shareholder Inspection Rights: A Comparative Analysis of China and the U.S. », European Corporate Governance Institute – Law Working Paper No. 499/2020.
Extrait :
Shareholder inspection rights allow a shareholder to access relevant documents and records of their company, so as to address the problem of information asymmetry inherent in the corporate form, and facilitate monitoring of the operation of the company and, if necessary, the bringing of further action for remedies.
In the United States (U.S.), all states have now codified shareholder inspection rights, albeit with some significant differences amongst them. Drawing upon overseas experiences such as the U.S. law, China has introduced the regime of shareholder inspection rights, but with some important adaptions made to its local environment. By providing access to relevant information, inspection rights have the potential to serve as an effective mechanism to deal with different types of agency problems in the company: not only the manager–shareholder conflict that is the most serious agency problem in the U.S., but also the conflict between majority and minority shareholders which mainly plagues the corporate governance system in China.
However, due to institutional differences, variations may exist between the two jurisdictions as to how inspection rights are structured and enforced. In our recent article, we thus compare shareholder inspection rights in China and the U.S. (that is mostly represented by Delaware, the preeminent corporate law jurisdiction in the U.S.), both in terms of the law on the books and the law in practice.
(…) Overall, we find that shareholder inspection rights play an important role in both the Chinese and US legal systems. While Chinese corporate governance and American corporate governance face different sets of agency cost problems, improved shareholder monitoring creates important benefits in both of them. There exist, however, some important differences in the structure and enforcement of the inspection rights regime between the two jurisdictions, which can be largely explained by reference to their different contexts of political economy.
À la prochaine…